Le travail énergétique est source de confusion. De très bons
ouvrages abordent longuement les notions de travail lactique, de
vitesse, de travail d'endurance et leur périodisation
respective.
Etant donné qu'il est déjà difficile d'être exhaustif dans les
meilleurs livres, vous comprendrez que cet article n'a pas la
prétention de répondre à toutes vos questions. Cependant il sera
ici exposé de manière simple et
claire ce que sont PMA (Puissance Maximale Aérobie), capacité
lactique, puissance lactique et puissance alactique (vitesse) et
ce qui différencie ces notions.
Mais tout d'abord, définissons la VMA, notion indispensable pour
comprendre les notions qui suivront. La VMA pour Vitesse
Maximale Aérobie correspond à la vitesse à partir de
laquelle vous serez à VO2max (votre consommation maximale
d'oxygène qui se mesure en mL/min/kg de poids de corps).
Autrement dit, si vous avez une VMA de 17 km/h, à partir de 17
km/h vous aurez atteint votre VO2 max (qui sera d'environ 60
mL/min/kg), et votre consommation d'oxygène n'augmentera plus
(dans l'hypothèse que vous ayez atteint ces 17 km/h
progressivement, la notion de déviation de la fréquence
cardiaque ne sera pas abordée ici). La VMA peut être tenue
entre 6 et 10 minutes selon les personnes et leur niveau
d'entrainement.
PMA : puissance maximale aérobie
Un travail de PMA se fait lors d'un effort compris entre 85% et
110% de VMA.
On peut choisir de la travailler en effort continu, ou il
s'agira de rester le plus longtemps possible à une intensité
donnée. Cependant il est difficile de rester plus de trente
minutes à 85% de VMA, excepté pour certains athlètes (les
champions de marathon le courent à plus de 80% de VMA en
moyenne).
C'est là que les efforts intermittents ou « fractionnés »
deviennent intéressants. Ils se pratiquent sur des temps de
courses allant de 15 secondes à 6 minutes entrecoupés de
récupération active. Ils permettent donc de passer plus de
temps à des intensités élevées et d'améliorer le maintien de
puissance lors de répétitions d'efforts à intensité élevée que
l'on retrouve dans les sports collectifs.
- Exemple de séance de travail intermittent long : (5 x 1'45'' à 85% de VMA) x 3 avec une récupération active de 1 minute entre les répétitions, et de 3 minutes entre les séries.
- Exemple de travail d'intermittent court : (30'' à 100% VMA/30'' récup active x 10) x 2 avec 4' de récupération active entre les séries.
Suivant le pourcentage de VO2max à laquelle on travaille, on obtiendra des adaptations périphériques et centrales différentes (amélioration du processus enzymatique oxydatif et glycolytique, capillarisation, développement des fibres FT, augmentation du volume d'éjection systolique…). Ces effets peuvent également être retrouvés en situation de jeu pour les sports collectifs (exemple : 3 contre 3 ou 4 contre 4 en football), mais étant dans sa zone de confort (le jeu) le sportif n'est pas dans une situation de résistance mentale et de dépassement de lui-même – indispensable sa réussite – que peut lui apporter le travail intermittent « classique ».

Ici n'ont pas été abordés les substrats énergétiques, mais pour comprendre pourquoi les fractionnés sont efficaces à la perte de masse grasse, je vous invite à la lecture de mon article « faut-il courir 40 minutes pour maigrir ? ».
Capacité lactique
Il s'agit d'efforts allant de 30 secondes à 2 minutes. A la
différence de l'intermitent training, les séances lactiques se
composent d'efforts courus à vitesse presque maximale entrecoupés
de peu de repos, peu actif.
Exemple de séance de capacité lactique : 8 x 400 mètres à
vitesse presque maximale (-2 à 3 km/h); 2 minutes de
récupération passive ou peu active entre les séries.
La récupération, bien que toujours supérieure au temps d'action,
doit être passive ou très légèrement active (assis, marche ou
très léger trottinage) et pas trop longue pour éviter la trop
grande élimination des ions H+ (et non des lactates)
responsables de l'acidose. Le but d'un travail en capacité
lactique étant de s'habituer à cette acidose musculaire.
Puissance lactique
Ce sont ici des efforts compris entre 30 et 50 secondes. La
vitesse est ici maximum, on peut parler de sprints longs.
Exemple de séance de puissance lactique : 8 x 45'' à
vitesse max. Récupération de 6 minutes passive, puis active dès
que possible (trottinage).
Ici on cherche en revanche à drainer les ions H+ avec une
récupération active. La recherche de qualité aspire à répéter
cette vitesse maximale.
Puissance anaérobie
Cela concerne les efforts explosifs, courts. C'est donc tout
simplement un travail de vitesse, donc de sprint, de force
explosive ou de pliométrie.
Exemple de séance de sprint : (4 x 100 mètres à vitesse
maximale) x 2 ; récupération de 5 minutes entre les répétitions
et de 10' entre les séries.
Attention, j'en profite ici pour préciser qu'un travail de
vitesse « pur » en ligne droite n'est pas très utile aux sports
collectifs ou les changements de direction sont fréquents. On
préfèrera des séances de vitesse accompagnées de changements de
direction, de demi-tours, de prises de décisions… Ceci vaut
également pour le travail de PMA détaillé ci-dessus, où les
séances incluant des changements de directions auraient un
impact plus important sur la fréquence cardiaque, la
concentration en lactate et la perception de l'effort.
Aussi, bien que le volume peut petit à petit augmenter, il est
nécessaire de garder en tête qu'un travail de qualité est
recherché lors de séance de vitesse, au risque d'entraîner
d'autre paramètre (endurance de vitesse).
En ce qui concerne les métabolismes énergétiques, il convient de
nuancer en précisant qu'aucune filière ne fonctionne seule. Il y
a juste, en fonction de la durée et de l'intensité de l'effort,
des dominances. On préférera plutôt donc parler de métabolismes
énergétiques que de filières.
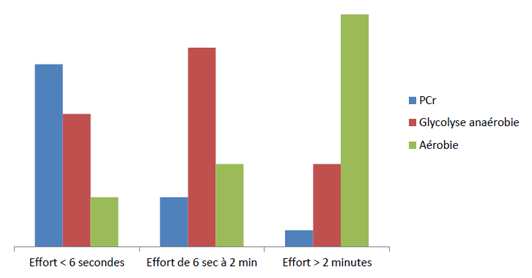
A noter aussi que ces trois métabolismes démarrent en même temps, leur dominance vient d'une lenteur du métabolisme aérobie qui « traine » à fournir de l'énergie sous forme d'ATP, le temps de passage du pyruvate dans la mitochondrie étant plus long que la glycolyse.
Références
1. La Préparation Physique Moderne d'Aurélien Broussal et Olivier Bolliet
2. Manuel d'entraînement de Jürgen Weineck
3. Le puzzle de la performance de Michel Dufour
4. Heart Rate Responses During Small-Sided Games and Short Intermittent Running Training in Elite Soccer Players: A Comparative Study. Dellal, Alexandre; Chamari, Karim; Pintus, Antonio; Girard, Olivier; Cotte, Thierry; Keller, Dominique.
5. Training Effects on Endurance Capacity in Maximal Intermittent Exercise: Comparison Between Continuous and Interval Training. Tanisho, Kei; Hirakawa, Kazufumi.
6. Repeated Sprint Training Improves Intermittent Peak Running Speed in Team-Sport Athletes. Hunter, Jayden R; O'Brien, Brendan J; Mooney, Mitchell G; Berry, Jason; Young, Warren B; Down, Neville.
7. Physiologic Effects of Directional Changes in Intermittent Exercise in Soccer Players. Dellal, Alexandre; Keller, Dominique; Carling, Christopher; Chaouachi, Anis; Wong, Del P; Chamari, Karim.



